XIXe siècle
-

Remerciements
Avant-propos de Philippe Kaenel : la presse satirique en Suisse
Introduction
Première partie
IDENTITÉ ET CHRONIQUE D’UNE REVUE SATIRIQUE ZURICHOISE
1. Genèse et figures
1.1. Décryptage de la fondation et de la vie éditoriale : focus sur Boscovits senior
1.2. La domination Boscovits
1.3. La configuration artistique et sociétale des dessinateurs
1.4. Ambitions voilées et assumées : de la délimitation avec les champs de l’art et de la presse
1.5. Liste et période d’activité des éditeurs et rédacteurs en chef
1.6. Liste et période d’activité des dessinateurs
2. Cycles de vie d’un organe bourgeois à l’identité complexe
2.1. 1875, un premier numéro fixant les choses : maquette, tendance, identité visuelle et commerciale
2.2. 1875-1886 : les années noir et blanc de l’ère Nötzli ou quand la Suisse prime sur le monde
2.2.1. Identité, maquette et technique – On affine
2.2.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Essor
2.2.3. Déclinaisons thématiques d’une tendance stable
2.2.4. Un langage visuel et rhétorique très typé
2.2.5. L’installation d’un appareil allégorique
2.3. 1887-1899 : ouverture, couleur et premier Jugendstil sous l’ère Nötzli
2.3.1. Identité, maquette et technique – Changements techniques et oscillations du titre
2.3.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – En avant toute
2.3.3. Thèmes et tendance – Ouverture et modernité
2.3.4. Rhétorique – Continuité et variations
2.3.5. Langage visuel – Jugendstil, Belle Époque et caricature
2.3.6. La constellation allégorique du Nebelspalter – Allégorie, femme et un monde à soi
2.3.7. Les couvertures Jugendstil, l’affirmation d’une identité
2.3.8. En voir de toutes les couleurs
2.4. 1900-1906 : Jugendstil versus Heimatstil – Retour aux fondamentaux
2.4.1. Identité, maquette et technique – Menace sur le cadre au trait
2.4.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Statu quo
2.4.3. Tendance et thèmes – Recentrage
2.4.4. Rhétorique – L’empreinte de la politique
2.4.5. Langage visuel – Acculturation du Jugendstil et recyclage de formules anciennes
2.4.6. La femme, le nu et l’allégorie
2.4.7. Du Heimatstil en couverture – Le Jugendstil helvétique
2.4.8. Les aléas de la couleur
2.5. 1907-1912 : remous, hésitations et révisions
2.5.1. Identité, maquette et technique – Le temps de la refonte
2.5.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Recadrage
2.5.3. Durcissement de tendance et primauté à la politique
2.5.4. Rhétorique – On monte le ton
2.5.5. Victoire du Heimatstil et confinement de l’image à l’illustration satirique
2.5.6. Recul de la représentation féminine et désinvestissement de l’allégorie
2.5.7. La valse des couvertures
2.5.8. Passage définitif à la couleur
2.6. 1913-1921 : l’image en perte et la Première Guerre mondiale
2.6.1. Identité, maquette et technique – Recul
2.6.2. Distribution, politique commerciale et lectorat – Sursauts et fuite en avant
2.6.3. Tendance et thèmes – Repli et ambigüité
2.6.4. Une rhétorique clivée
2.6.5. Le chant du cygne de l’image
2.6.6. Divorce de la femme et de l’allégorie
2.6.7. Dilution de la couleur
Deuxième partie
UN CERTAIN REGARD SUR LE MONDE
3. Regard sur un monde aux déclinaisons plurielles
3.1. Une iconographie du monde 107
3.1.1. 1875-1886 : figures et motifs d’une ouverture a minima
3.1.2. 1887-1914 : déclinaisons d’un univers en expansion et d’une Europe impuissante
3.1.3. 1914-1921 : embrasement et no man’s land d’un univers en perdition
3.2. La Suisse versus Zurich : critique et iconographie
3.2.1. Le face-à-face (helvétique) du Nebelspalter avec Helvetia
3.2.2. L’alliance sacrée ou la Suisse du Nebelspalter
3.2.3. Chronique visuelle d’une ville : Zurich
3.3. La Première Guerre mondiale : la « drôle » de guerre d’une revue
3.3.1. Se situer vis-à-vis d’un conflit étrange
3.3.2. Rire en guerre
3.3.3. Montrer la guerre et renoncer au rire
3.3.4. L’après-guerre : ressassements en images
Troisième partie
CULTURE, ART ET POLITIQUE :
DISCOURIR ET PRENDRE SA PLACE
4. Discours sur l’art
4.1. La question de l’art suisse
4.2. Rendre compte des expositions et régler ses comptes via les expositions
4.3. Le salon caricatural du Nebelspalter ou la critique de la modernité
4.4. Le couple Arnold Böcklin et Ferdinand Hodler
4.5. Plaider et batailler pour la pierre à Zurich : le Kunsthaus et le Musée national suisse
4.6. La maigre réception des mouvements contemporains
5. Emprunts, transferts et autoréférentialité
5.1. Le Nebelspalter, la caricature et les revues illustrées européennes
5.2. S’enrichir du « grand art »
5.3. Le statut très particulier de Arnold Böcklin et Ferdinand Hodler
5.4. Transpositions médiales
5.5. Se citer soi-même plus que de mesure
6. Des affaires de réseaux
6.1. La leçon des archives Nötzli : un éditeur et ses réseaux
6.2. Intrigues suisses et influences françaises dans le monde éditorial: Jean Nötzli, John Grand-Carteret et Cäsar Schmidt
6.2.1. Acte un : correspondance entre Jean Nötzli et John Grand-Carteret de 1880 à 1891
6.2.2. Acte deux : 1897, querelle autour de l’« Europe actuelle »
6.3. Quand politique, art et satire se mêlent : Numa Droz et Jean Nötzli
6.4. Passions d’artistes : Richard Kissling, Evert van Muyden, Henri van Muyden et Jean Nötzli
Conclusion
Bibliographie sélective
Travaux académiques sur le Nebelspalter
Travaux académiques s’appuyant sur le Nebelspalter de manière significative
Publications de vulgarisation sur le Nebelspalter en provenance des éditions du Nebelspalter
Publications de vulgarisation sur le Nebelspalter en provenance d’autres maisons d’édition
Index
Table des illustrations
Crédits photographiques
-
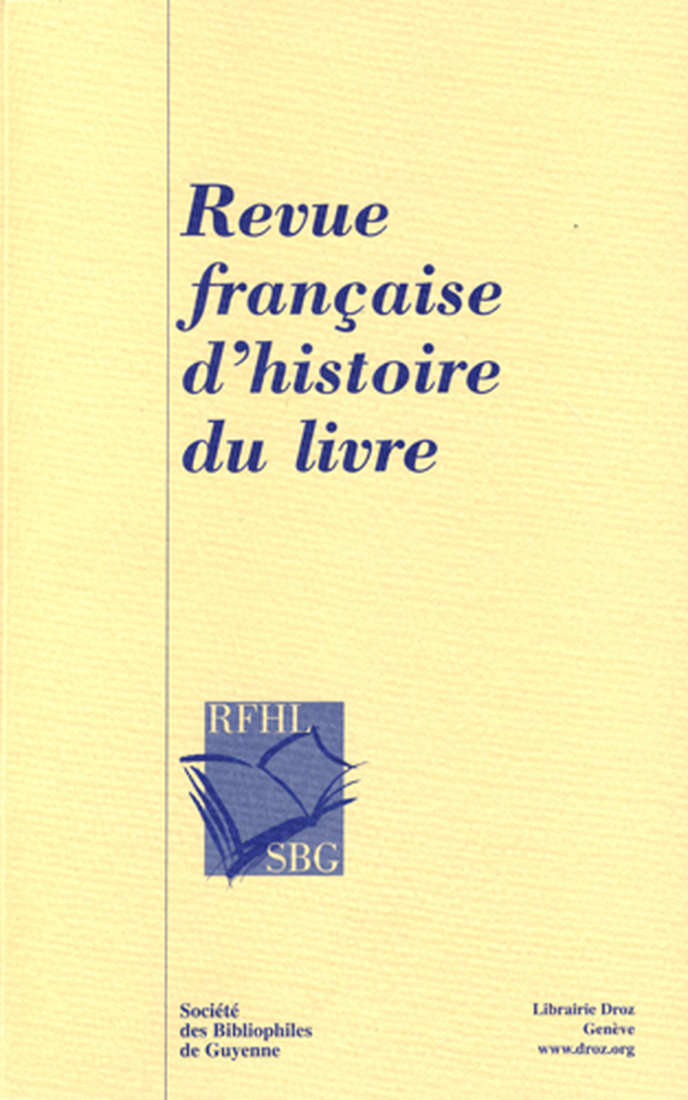
Sommaire: Études - Actes du LXXe colloque de la Fédération historique du Sud Ouest
(Bordeaux, 30 septembre-1er octobre 2017 : Archives, manuscrits et imprimés) - M. NAVARRO CABALLERO, « Les Inscriptions latines d’Aquitaine : les archives de la population romaine d'Aquitaine »; F. LAINÉ, « Nécrologes et obituaires du Sud-Ouest.
Du manuscrit à l'édition »; S. LAVAUD, T.-L. ROUX et A. STELLA, « L'écrit municipal à Agen au Moyen Âge »; S. DRAPEAU, « Instantané d'un chantier hors norme : la comptabilité de l'œuvre de Saint-Michel de Bordeaux (1486-1497) »; J.-P. POUSSOU, « De l'importance et du rôle de l'information durant les grandes crises politiques anglaise et française du milieu du XVIIe siècle »; G. TAFFIN, « Modalités de conservation et enjeux actuels des archives des juges-consuls »; L. COSTE, « Le mémorandum d'Antoine Gautier : de l'écriture à la diffusion »; F. CADILHON, « Thérèse Desqueyroux : François Mauriac et ses voisins »; S. MIQUEL, « Inventaires floristiques et archives botaniques
en Périgord »; S. HOLGADO et C. JACOBS, « Gardien du temps ou l'éternel recommencement, du XVIIIe siècle à nos jours : une bataille impossible contre les misères du temps »; M. AGOSTINO, « La préservation d'un document exceptionnel
au cinéma. Le cas de deux films, Le Nom de la rose et Citizen Kane » ; A. ROQUAIN, « À propos de deux livres ayant appartenu à Lope de Vega : Il gentilhuomo et Avvertimenti morali de Muzio / Épitomé de Florus et Histoire de Polybe » ; F. ROUGET, « La réception éditoriale posthume des Œuvres de Philippe Desportes (1611-1621) »; H. VAN DER LINDEN, « Un ensemble de rares publications éphémères françaises du XVIIe siècle (Harvard, Houghton Library, *88-474a) : aperçu et inventaire »; M. JAOUHARI, « Les manuscrits arabes du général Daumas (1803-1871) » - II. Variétés - Lyse SCHWARZFUCHS, « Devises et marques dans le livre imprimé en terre francophone au XVIe siècle : Paris, Lyon, Genève »; A. GALLET, « La monographie botanique » Comptes rendus.
-

Comment se fait-il que nombre de poètes parmi les plus influents de la seconde moitié du xixe siècle, des maîtres du Parnasse à Mallarmé, aient eu tant de mal à publier des livres ? Situé au croisement de l’histoire de l’édition et de l’analyse littéraire, ce livre tâche de répondre à cette question, parmi d’autres, en considérant le contexte éditorial de l’époque, caractérisé par le triomphe du roman aux dépens de la poésie, et en examinant les cas singuliers de quelques poètes, en particulier Verlaine, Rimbaud et Mallarmé. Confrontés à des difficultés croissantes, devenues souvent insurmontables, dans leurs tentatives respectives de publier des livres, ces poètes ont été contraints de trouver d’autres supports d’inscription et de diffusion pour leurs œuvres (le volume collectif, la petite revue, l’album, le livre d’artiste, etc.), en marge de l’édition régulière. Le propos de ce livre est de montrer que cette multiplication des supports a grandement contribué au renouvellement des formes poétiques à la fin du siècle et, en définitive, à la réinvention du livre de poésie.
-

Les portraits littéraires de Sainte-Beuve sont un peu les intérieurs hollandais de la littérature française. Si l’on considère le poète qu’il fut – celui de Vie, poèmes et pensées de Joseph Delorme, des Consolations et des Pensées d’août –, le romancier de Volupté, tant prisé par Baudelaire et Flaubert, l’historiographe de Port-Royal enfin, c’est autour d’une ontologie de l’intime que l’ensemble de l’œuvre peut se recentrer. Ce livre s’efforce de suivre l’expérience et la pensée de l’intime chez Sainte-Beuve, en ses inflexions psycho-morales, politiques et stylistiques. Une première partie regroupe ces « fables romantiques du sujet » que sont Joseph Delorme, Volupté et, dans son prolongement, le terminus ad quem de l’éros romantique : Dominique de Fromentin. Une deuxième partie, fondée sur le postulat qu’il n’est rien de plus créatif que l’inimitié littéraire, étudie les dialogues entravés avec Balzac – le contemporain de loin le plus haï –, Chateaubriand, et Proudhon. Une troisième partie explore la poétique du portrait et dans les Lundis et dans ce qui est à la fois une contre-épopée des vaincus de l’Histoire et l’élégie d’une religion finissante, l’inépuisable Port-Royal.
-

TABLE DES MATIÈRES
NOTE SUR CETTE RÉÉDITION
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AVANT-PROPOS
Introduction
DE LA RELIGION ET DE L’IDÉE DE DIEU AU XIXe SIÈCLE
I. UN RENOUVEAU RELIGIEUX
1. Le « libéralisme » religieux
2. Le « socialisme » religieux
II. LA QUESTION DE DIEU
1. La théologie romantique
2. La critique philosophique
3. La solution panthéiste : le bouddhisme
4. De Dieu à l’inconscient
5. Inconscient et religion : la foule
III. DESTINÉE DU CATHOLICISME
IV. LA RELIGION DE L’AVENIR
Première partie
L’ÉVOLUTION SPIRITUELLE DE MALLARMÉ D’HÉRODIADE À IGITUR
I. LES ANNÉES DE MATURATION : 1863-1865
1. Un début dans la vie
2. Naissance d’Hérodiade
3. La « Scène »
4. L’« Ouverture » ancienne
II. LA CRISE : FÉVRIER-MAI 1866
1. Les causes
— L’« Ouverture »
— Cannes
— Le crépuscule d’une idole
2. Des perspectives nouvelles
III. LA VOIE INTROSPECTIVE : JUIN 1866-DÉCEMBRE 1868
1. Retour sur soi
2. Montégut, Phidias, Léonard
3. La poésie comme exercice spirituel
4. L’impasse de l’absolu
IV. LA VOIE SCIENTIFIQUE : JANVIER 1869-1870
1. Un Discours de la Méthode
2. Igitur
3. La Thèse
Deuxième partie
LES DIEUX ANTIQUES
I. MYTHOLOGIE ET RELIGION
1. La mythologie des Idéologues
2. La mythologie romantique
3. La révolution linguistique
4. En marge de la science
— Un Mage : Eliphas Lévi
— Un Maçon : Ragon de Bettignies
— Un Païen mystique : Louis Ménard
II. VERS LES DIEUX ANTIQUES
1. L’Egyptologie mallarméenne
2. D’Hachette à Rothschild, via Longman
3. Un certain George William Cox
III. DE COX À MALLARMÉ
1. L’ordonnance générale
2. Le texte
— Notes et renvois
— Le cas Max Müller
— Coquilles et contresens
— Interpolations
— Omissions ou coupures
3. La question religieuse
4. La théologie des Dieux antiques
Troisième partie
ART ET RELIGION
CHAPITRE PREMIER. WAGNER
I. LA « RÊVERIE D’UN POËTE FRANÇAIS »
1. Théâtre et musique
2. Mythes et religion
— Le « ruisseau primitif »
— La question nationale
— Une mythologie désuète
II. L’« HOMMAGE » À WAGNER
1. De la « Rêverie » à l’« Hommage »
2. Le « Livre » wagnérien
3. Le « dieu Richard Wagner »
III. LOHENGRIN
1. Le scandale
2. De Wagner à Banville
IV. ULTIMA VERBA
CHAPITRE II. LE THÉÂTRE
I. HISTOIRE D’UNE PASSION
II. PARADOXE DE LA CRITIQUE
III. L’ESTHÉTIQUE THÉÂTRALE DE MALLARMÉ
1. Un mythe fondateur
2. Un théâtre impersonnel
3. Le ballet
4. La pantomime
5. Théâtre et livre
6. Le mélodrame
7. Théâtre et poésie
8. La foule
IV. LA RELIGION THÉÂTRALE DE MALLARMÉ
1. Le théâtre de la nature
2. Théâtre et société
CHAPITRE III. INTERMÈDE FORAIN
CHAPITRE IV. LES CONCERTS DOMINICAUX
I. MUSIQUE ET SOCIÉTÉ
II. MUSIQUE ET MÉTAPHYSIQUE
1. Le mystère musical
2. Musique et nature
CHAPITRE V. LE CATHOLICISME
I. « DE MÊME »
1. Des « pompes selon l’art »
2. Archéologie du catholicisme
— La nef, ou l’« invitation directe à l’essence du type »
— Le prêtre, ou l’invisibilité du type divin
— L’orgue, ou l’élargissement du lieu jusqu’à l’infini
3. Une « vision d’avenir »
II. « CATHOLICISME »
1. L’avenir de la religion
2. La religion : affaire publique ou affaire privée ?
3. Vers une religion nouvelle
— La « représentation avec concert »
— Le théâtre
— La messe
Quatrième partie
RELIGION, NATURE, SOCIÉTÉ
CHAPITRE PREMIER. DU CÔTÉ DE VALVINS : LA NATURE.
I. LE POÈTE AUX CHAMPS
1. Une rêverie hygiénique
2. Une mystique de la source
II. LA TRAGÉDIE DE LA NATURE
1. Préhistoire d’une tragédie
2. La « tragédie de la nature »
3. « La Gloire »
4. « Conflit »
CHAPITRE II. LA SOCIÉTÉ
I. D’UNE CRISE L’AUTRE
II. LA SOCIÉTÉ, OU DU « CENTRAL RIEN » AU NÉANT FONDATEUR
1. Une illusion philosophique
2. Le « central rien », ou la cité trouée
3. De la cité antique à la cité moderne
4. Un rêve de coupole
III. DES FÊTES NATIONALES
CHAPITRE III. L’OR
I. UN ARCHÉTYPE IMAGINAIRE
1. De l’or prodigue
2. … à l’or caché
II. LA RELIGION DE L’OR
1. L’Or-dieu
2. Le poète et le prolétaire
3. Le poète et l’or
4. Aristocratie et démocratie
III. LE CRÉPUSCULE D’UN DIEU
Cinquième partie
UNE THÉOLOGIE DES LETTRES
I. MYTHOLOGIE ET POÉSIE : LES DIEUX ANTIQUES
II. LINGUISTIQUE ET POÉSIE : LES MOTS ANGLAIS
III. POÉTIQUE ET POÉSIE
1. Le « Mystère dans les Lettres »
2. Une théologie des lettres
Sixième partie
LIVRE ET RELIGION
I. DES DIEUX ANTIQUES AU LIVRE
1. Le Livre dans les Divagations
2. Le « Livre » de Mallarmé
3. Le Mystère d’Hérodiade
II. L’ACTION RESTREINTE
1. Une religion privée du livre
2. Livre et public
3. Livre et théâtre
III. UNE RELIGION DU LIVRE ?
1. Une récitation publique
2. Un rituel académique
3. Les séances du « Livre »
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INDEX DES TEXTES DE MALLARMÉ
INDEX NOMINUM
-

Le voyage en Andalousie au XIXe siècle apparaît comme une réponse à la double révolution mimétique et médiatique à laquelle la littérature est alors confrontée. C’est avec les dispositifs de la modernité (lithographie, photographie, littérature journalistique) que dialoguent les écrivains-voyageurs dont les textes sont ici étudiés : Laborde, Chateaubriand, Taylor, Irving, Gautier, Dumas père, Botkine, Andersen, De Amicis, etc. C’est pourquoi ces objets littéraires aux statuts génériques et éditoriaux divers (voyages pittoresques, contes, feuilletons, lettres…) doivent être replacés dans l’environnement des productions culturelles liées à l’Andalousie à l’époque : le Handbook espagnol de Richard Ford, les photographies de Charles Clifford et de Jean Laurent, les études qu’Owen Jones publie sur l’Alhambra, l’Exposition universelle de Londres en 1851, ou encore les illustrations que Doré donne pour L’Espagne de Davillier. Au terme de ce parcours, on comprend comment, de la rencontre d’un genre problématique – le récit de voyage – et d’un espace auquel se superposent des loci parfois contradictoires – l’Andalousie –, naissent des pratiques révélatrices de ce que la modernité romantique fait à la littérature.
-

Table des matières
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE
LA PROSTITUÉE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE, DU RÉEL À LA FICTION :
CONTEXTUALISATION
Chapitre premier. La prostituée et la définition du féminin
Un Etre faible
La faiblesse anatomique de la femme
Un sens moral inférieur
Un être instable
Un Etre sensible
Le sentiment amoureux
L’imagination
La menace de la folie
L’Autre
Un être hyper sexualisé
L’objet d’un discours angoissé sur la sexualité
L’Autre femme
Chapitre II. Un reflet déformant d’une réalité sociale
Une réflexion sur les causes de la prostitution
Des causes structurelles
De l’entrée dans la prostitution
Des causes de la prostitution dans la fiction
La prostitution entre 1860 et 1890 : un phénomène réglementé
Diversité du fait prostitutionnel
Géographie comparée de la prostitution
De la prostitution officielle
Des limites du système réglementariste
Un sujet de polémiques
La prostitution au sein du débat sur l’anthropologie criminelle
Les revendications abolitionnistes
La prostitution, sujet de réformes dans la fiction ?
Chapitre III. L’Élaboration d’un nouveau sous-genre romanesque
Le fer de lance d’une nouvelle esthétique
Un ennemi commun
Le pilier de revendications littéraires
« Les “filles” du roman moderne » : l’avènement d’un personnage nouveau en littérature
Une fiction codifiée
Le personnel du roman de la prostituée
Vers un schéma narratif
Les scènes attendues
L’art difficile de la variatio
Du souvenir à la cérémonie d’hommages
Nana, apogée et point de retournement
Les signes d’un essoufflement rapide
deuxième PARTIE
La pROSTITUÉE, une figure du manque
Chapitre IV. Prostituée et dépossession
L’isolement de la prostituée
La coupure familiale
Le mépris social
Une exclusion sociale institutionnalisée
Un corps pour autrui
Un corps paré
Un « corps exposé »
Un corps désarticulé
L’aliénation de soi
Dépersonnalisation
Aliénation de l’esprit
Effacement identitaire
Chapitre V. « Le soleil noir de la Mélancolie »
L’absence d’emprise sur le réel
Velléité
Passivité
Destruction involontaire de soi et des autres
Voyage au bout de la nuit : une impossible affirmation de soi
Contradiction
Répétition
Dissolution
La mort dans la vie
Oubli et insensibilité
Discrétion langagière, mutisme, aphasie
Suicide réitéré et prolongé
Chapitre VI. Une angoisse du vide
Quelques métaphores de la vacuité de l’Etre
Le fade, l’informe et l’impersonnel
Masques et reflets : la multiplication des simulacres
La béance ou le gouffre
Huysmans et la menace du naufrage
Edmond de Goncourt et l’obsession du trou noir
Zola et la « femme-abîme »
Le vide entre attraction et répulsion
Vide et séduction des autres
Vide et mélancolie : l’abjection de soi
L’innommable
L’indistinction
La corruption et la maladie
Troisième PARTIE
ÉCRIRE LA PROSTITUÉE OU LA CONJURATION PAR L’ÉCRITURE
Chapitre VII. La prostituée et les angoisses de l’homme de la seconde moitié du XIXe siècle
Une image des bouleversements socio-economiques : la prostituée et l’émergence de la masse
Une économie en mutation
Un nouveau régime politique en élaboration, la démocratie
Un discours désenchanté sur le politique
L’hypocrisie sociale : un monde des apparences
Une allégorie de l’impasse historique
Nana, impératrice burlesque
Isidora, l’Histoire à contre-temps
Un questionnement identitaire sur l’altérité
La relation à autrui
Le rapport à l’autre sexe
Un difficile rapport à soi
La prostituée et le rapport de l’homme à son corps
La Prostituée et la mort
La thématique du suicide
Ecrire l’inexistence
Ecrire la mort d’autrui
Chapitre VIII. La prostituée et l’artiste
Une vendeuse d’illusions
Artificialité et authenticité
Le pouvoir de transmutation de la réalité en art
L’artiste prostitué ou l’Ere de la littérature publique
La place de l’artiste dans la société
La prostituée et le client ou de la séduction littéraire
La marchandisation du sexe et de l’art
La mélancolie de l’artiste
Stérilité et angoisse du silence
Création littéraire et dissolution du moi
Chapitre IX. La prostituée ou l’affirmation de la dépossession
Dépossession et affirmation paradoxale du personnage
Un moyen de préservation de soi
Eviter le morcellement du moi
S’affirmer dans l’effacement de soi
S’affirmer par le suicide
Une arme, un pouvoir de rébellion
Une force « mythifiante »
Isidora et l’orgueil
Nana, nouveau mythe de la sexualité féminine
Sonia et les figures religieuses
Dépossession et affirmation spirituelle
Dépossession et humilité
Dépossession et souffrance
Dépossession et amour de l’autre
Dépossession et affirmation esthétique : un signe de modernité
Le roman de fille ou le dénuement du récit : une remise en cause de l’art romanesque
Vers une esthétique de la discontinuité
CONCLUSION
Annexes
Annexe 1. Repères : les grandes dates de l’histoire de la prostitution au XIXe siècle
Annexe 2. Repères : les grandes dates de l’histoire de la prostitution au XXe siècle
Annexe 3. Romans et nouvelles du XIXe siècle sur la prostitution
Bibliographie
OEuvres primaires
Autres oeuvres utilisées des auteurs étudiés
Etudes critiques sur les auteurs étudiés
Sur le contexte littéraire des oeuvres étudiées
Etudes critiques sur la prostituée dans la littérature du XIXe siècle
Etudes critiques sur la femme dans la littérature du XIXe siècle
Données socio-historiques. Femme, prostitution, société : Etudes du XIXe siècle
Histoire de la prostitution : Etudes du XXe siècle
Femme, sexualité, société : histoire des idées et des représentations
Ouvrages généraux sur la langue et la littérature
Index des auteurs
Index des titres
Au moment où la prostitution semble exploser dans les villes, la fille des rues envahit la littérature de la seconde moitié du XIXe siècle. Héroïne nouvelle, elle acquiert bien vite le premier rôle de ce qui devient un sous-genre romanesque à part entière, doté d’une structure et de motifs privilégiés. Pour appréhender le fonctionnement et les significations multiples que ce personnage revêt dans le « roman de fille », cette étude comparée d’œuvres françaises, espagnoles et russe s’ouvre sur les discours médicaux, moraux et sociaux du temps sur la femme et la prostituée. Figure du manque et de la dépossession, la prostituée interroge la vision masculine du féminin, mais traduit aussi les inquiétudes des contemporains face aux nombreuses mutations sociales, économiques et politiques du siècle, et se fait le reflet d’angoisses existentielles sur le rapport au corps, aux autres et à la mort, ainsi que le lieu privilégié de réflexions artistiques et esthétiques.
-

La dissertation : un exercice scolaire au service de la formation de l’élite masculine ? A Genève et plus largement en Suisse romande, le processus de fabrication de la dissertation est lié en réalité au développement des écoles secondaires de jeunes filles qui s'organisent dès 1848 autour d’une culture moderne, dans laquelle le français prend le statut de voûte, la dissertation, celui de clé. A la suite des premières remises en cause de l’exercice à partir de 1955 pour son caractère élitiste, l'exercice ne disparaît pas. Il est cependant reconfiguré en profondeur dès 1980, en particulier dans la filière non gymnasiale désormais mixte : d'un moyen d'évaluation de la culture générale de l'élève, la dissertation devient progressivement un genre argumentatif permettant d'évaluer la culture scolaire littéraire acquise par l'élève dans le cours de français. Cette étude montre ainsi comment la dissertation en tant qu’exercice scolaire apparaît et se développe dans le cadre d’un projet politique précis, la démocratisation de l’enseignement, impliquant la mise en place d’un nouveau modèle de formation, la culture générale, dans lequel le français joue tout au long du XXe siècle le rôle de fer de lance.
-

TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS
INTRODUCTION
D’UNE RENAISSANCE À L’AUTRE
Goût et esprit de la Renaissance au XIXe siècle
Renaissance romantique
Actualité de la Renaissance
Instrumentalisations politiques du XVIe siècle
Renaissance révolutionnaire
PREMIÈRE PARTIE
LA FABRIQUE ROMANTIQUE DES TEMPS MODERNES
CHAPITRE PREMIER
MISES EN INTRIGUE DE LA RENAISSANCE ROMANTIQUE
Expansions, transitions, ruptures
L’avènement des Temps modernes ; Périodiser la « zone Renaissance » : trois mises en intrigue ; De la transition à la rupture : Michelet et Quinet
La catholicisation de la Renaissance
Ténèbres de la Renaissance ; Palingénésies et syncrétismes ; « Recatholisation »
Configurations « troubadour » et révolutionnaire : l’exemple
de la chevalerie
Renaissance « troubadour » ; Renaissance romantique ; Renaissance moderniste
CHAPITRE II
LA RÉFORME ET LES TEMPS MODERNES : RÉSISTANCE, RÉVOLUTION, DÉCHÉANCE
L’aurore contestée de la Réforme
A rebours et en avant : la Réforme et ses révolutions ; Modernités de la Réforme : résistance et opposition ; La Réforme, un contre-génie de la modernité
Du libre examen et de l’individualisme
Stendhal et la souveraineté morale de l’individu ; Mérimée et le scepticisme de la liberté individuelle ; Balzac et les enjeux politico-philosophiques de l’esprit d’examen
De la Réforme comme mouvement révolutionnaire
Réforme, résistance, révolution ; Antiprotestantisme et antilibéralisme ; Esprit révolutionnaire et opposition
DEUXIÈME PARTIE
LÉGITIMER LE POUVOIR : INSTRUMENTALISATIONS IDÉOLOGIQUES DES GUERRES DE RELIGION
CHAPITRE III
LE « BON HENRI » DANS TOUS SES ÉTATS
Le siècle d’Henri IV
La légende royaliste d’Henri IV ; Un succès de librairie
Henri IV au théâtre
Henri IV et la réconciliation nationale ; Paternalisme royal ; Le corps collé et cloné d’Henri IV : la restauration des deux corps du roi
Le rétablissement de la statue équestre d’Henri IV
Instrumentalisations politiques ; Odes à Henri IV et à la monarchie restaurée ; Restauration du modèle eucharistique
CHAPITRE IV
LE « SIÈCLE DES GUISE ET DES VALOIS » : MISE EN FICTION DES GUERRES DE RELIGION
Réconciliation nationale et résistance politique
Réconciliation nationale et retour à l’ordre ; Vers une nouvelle Saint-Barthélemy ; Dramatisation romantique de la Renaissance
Les vérités du XVIe siècle
Vérité historique, vérité poétique ; Les limites de la vérité historique ; Les leurres du fac-similé
Conservatisme subversif : masculinités pittoresques et légitimation du pouvoir
Dévirilisation et délégitimation du pouvoir ; Survirilisation : légitimité restauratrice et usurpatrice ; Masculinité féminine et légitimité révolutionnaire ; Alternative et idéal masculin : légitimité de droit
CHAPITRE V
LITTÉRATURE D’OPPOSITION ET GUERRES DE RELIGION
Résistance aux anachronismes politiques
L’apprentissage du constitutionnalisme ; Fanatisme religieux et absolutisme politique
Modération et mobilisation
Les grands hommes et l’appel à la sagesse et à la modération ; Appel à la mobilisation et peur d’une nouvelle anarchie
Oppositions républicaine et légitimiste après 1830
Renforcer la conscience nationale ; Confirmer la conscience catholique ; Encourager la conscience révolutionnaire
TROISIÈME PARTIE
DES RÉVOLTES ET DES LIBERTÉS
CHAPITRE VI
L’ÂGE DE L’ORGIE : PASSIONS EN LIBERTÉ, LIBERTÉ DES MOEURS
Moeurs à l’italienne : passions énergiques, désirs de liberté
Immoralisme et génie ; Immoralisme et énergie : Stendhal ; Christianiser l’immoralisme : Hugo ; Immoralisme et liberté : Musset
L’immoralisme français entre admiration et réaction patriotique
Translation des moeurs : « un pays d’enchantement » ; Admiration de l’immoralisme : Stendhal et Mérimée ; Immoralisme et anti-italianisme
Le charme discret de l’immoralisme
Embourgeoisement et transgressions aristocratiques ; Une sexualité débridée ; Pouvoir féminin et désordre moral
CHAPITRE VII
LES LIBERTÉS DU GÉNIE ARTISTIQUE
Les arts de la Renaissance entre christianisme et paganisme
Hostilités conservatrices ; Querelle sur Raphaël : Chateaubriand ; Paganisme libéral et révolutionnaire : Esquiros et Michelet
La Renaissance des arts entre protestantisme et civilisation moderne
Arts et luxe ; Esthétique catholique et éthique protestante : Staël, Chateaubriand, Guizot ; Modernité de l’art renaissant : Stendhal, Hugo, Musset ; Esthétique et protestantisme : les noces politiques
Nationalisme et légitimité nationale de l’art renaissant
Nationalismes ; Syncrétismes : Chateaubriand, Hugo ; Légitimité nationale : Michelet et Quinet
Renaissance désenchantée : destinées mercantiles et contestataires
Désir de renouveau et éternel artistique ; Professionnalisation du génie ; Désenchantements et échecs ; Révoltes et combats
CHAPITRE VIII
SAVOIRS EN LIBERTÉ : LIBIDO SCIENDI, LIBIDO DOMINANDI
Imprimerie et liberté de pensée
Progrès de l’esprit humain et des libertés : Hugo ; Dangers de la parole dévoilée : Nodier, Nerval ; Renaissance et opinion politique : Vitet, Balzac, Michelet
Les difficultés de la modernité : humanistes, inventeurs, navigateurs
Humanisme « capacitaire » ; Marginalisation et méfiance de l’esprit créateur ; Colonialisme idéologique des découvertes
Pouvoir et savoir des sciences
Epistémologie et sciences occultes ; Politique des sciences occultes ; Sciences occultes et religion
CONCLUSION
VERS UNE RENAISSANCE DU MOI
ANNEXE
LA RENAISSANCE ROMANTIQUE MISE EN FICTION
BIBLIOGRAPHIE
Sources : littérature et histoire
Seizième siècle : historiographie et réception
Etudes critiques : littérature et histoire
INDEX NOMINUM
Le début du XIXe siècle compose une Renaissance qui lui permet de réfléchir à son actualité intellectuelle et politique. Bien avant Michelet, presque tous les auteurs ont diffusé des images d’une époque très controversée : Chateaubriand, Balzac, Dumas, Musset, Mérimée, Stendhal et bien sûr Hugo. Concept métahistorique, « singulier collectif » englobant toutes les expériences fondées sur l’idée du renouveau, la Renaissance romantique est intégralement liée à l’expérience récente de la Révolution française. Que ce soit pour célébrer la restauration de la monarchie des Bourbons, contester un pouvoir irrespectueux des acquis révolutionnaires validés par la Charte, ou encore exprimer les espoirs déçus des Trois Glorieuses, les précédents du XVIe siècle offrent un arsenal d’arguments qui se prêtent à la manipulation à des fins de propagande, de combat politique ou de résistance. Cette somme propose une vision d’ensemble de cette Renaissance romantique, de l’instrumentalisation politique à l’usage idéologique, de la construction historiographique aux représentations littéraires.
-
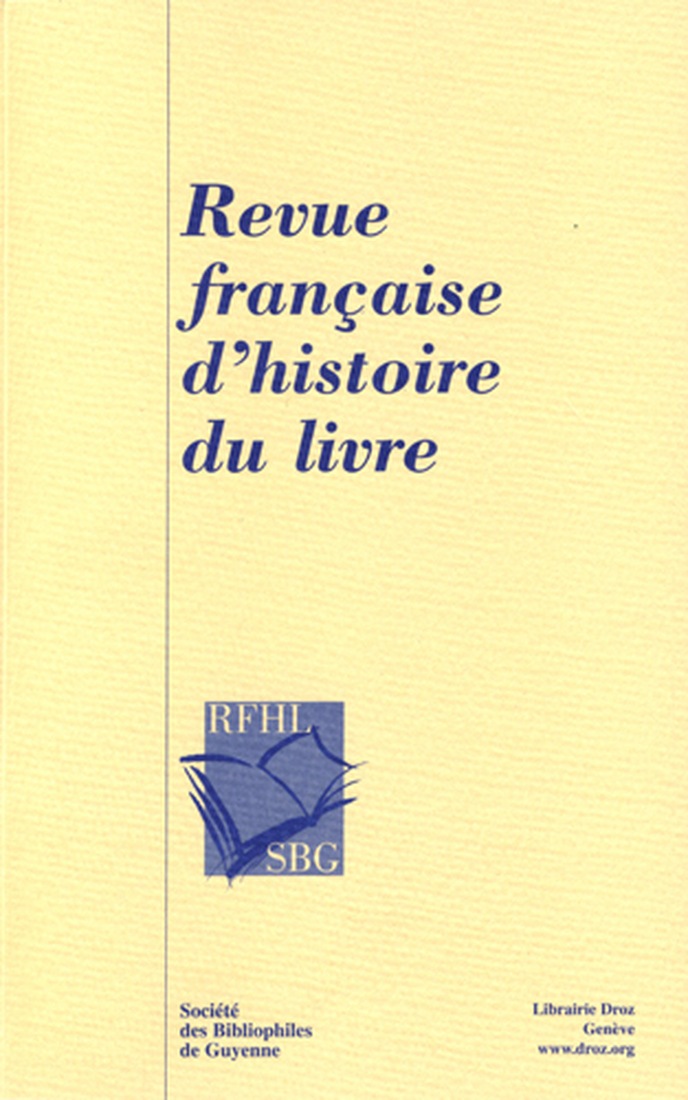
Sommaire
I. Etudes - Samuel GRAS, "L'atelier de Jean Poyer à Madrid. Un missel au temps des fiançailles de Charles VIII et Marguerite d'Autriche"; Annalisa MASTELOTTO, "Au fil des pages: les notes marginales de l'exemplaire de travail de la Bibliotheca Universalis de Gesner consacrées aux auteurs italiens"; Evelien CHAYES, "Bibliothèques bordelaises à l'époque de Montaigne"; Dominique VIDAL, "Le Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes de bibliothèques au XVIIIe siècle, de Jacques-Auguste de Thou à Jean-Baptiste Huzard"; Peter NAHON, "Un regard bordelais sur le rite comtadin en 1847, assorti de quelques notes sur la disparition de celui-ci"; Michel WIEDEMANN et Pierre COUDROY DE LILLE, "Les hommes illustres de Plutarque à nos jours: à propos d'une collection de François Séraphin Delpech"; Christophe BLANQUIE,: "L'érudit, l'évêque et le ministre: le premier Tamizey de Larroque"; Xavier ROSAN, "L'écrivain Louis Emié (1900-1967) et les arts"; Nathalie DIETSCHY, "Le livre d'artiste: au-delà de la page à l'ère digitale" - II. Variétés - André GALLET, "Corisande, Henri de Navarre et Montaigne"; Gilles DUVAL; "Registre de sommet et Cartes de visite, des imprimés parfois négligés: l'exemple du Pic Long (3.192 m), 1928-1939".